
8- LES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES
Lorsque vous aurez expérimenté la micro-fusée telle qu'elle vient de vous être décrite, si vous avez l'esprit un tant soit peu curieux et scientifique, vous aurez envie de compliquer un peu vos montages.
GROUPEMENT DE MOTEURS
L'une des premières pensées qui nous vient est de vouloir fabriquer
une fusée plus importante afin d'emporter du matériel : plusieurs
parachutes, ou un accéléromètre, ou des confetti, etc...
(ce ne sont pas les idées qui vous manqueront...).
Il vous faut pour cela un moteur puissant : il suffit de grouper 2 ou 3 moteurs
en parallèle.

Puisque vous êtes astucieux, la construction ne vous causera pas trop de problèmes : veillez à la bonne étanchéité du compartiment qui devra éjecter le système de récupération et à la position du centre de gravité.
Le seul point sur lequel vous buterez sera la mise à feu simultanée de tous les moteurs : deux méthodes sont utilisées :
1 - ALLUMAGE PAR 3 ALLUMEURS BRANCHÉS EN PARALLÈLE :
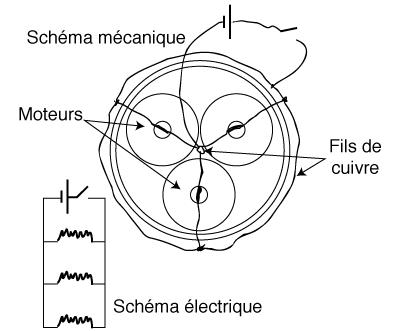
2 - ALLUMAGE PAR MICRO-MOTEUR :
Un micro-moteur est un propulseur fixe utilisé comme allumeur d'un propulseur mobile. Dans ce cas, nous avons utilisé un moteur d'impulseur A8-0 fixé à un bloc allumeur percé de 3 canaux aboutissant aux 3 moteurs.
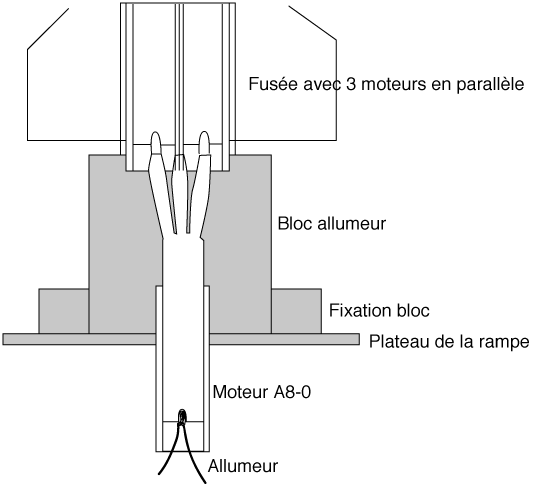
CONDITIONS EXPÉRIMENTALES
1) Utiliser des propulseurs à temps de combustion long et à poussée
constante (B6-4, C6-5...).
2) Assurer la symétrie et le parallélisme des moteurs par rapport
à l'axe longitudinal de la fusée.
3) Choisir des allumeurs recouverts d'une couche de poudre identique et les
couper à la même longueur.
4) Mettre la batterie d'alimentation au pied de la rampe et commander la mise
à feu à distance par l'intermédiaire d'un relais.
5) Les deux fils d'allumage reliant la batterie aux allumeurs doivent pouvoir
suivre la fusée durant son parcours sur la rampe en profitant de son
guidage, d'où le rôl du pylône.
6) Relier les allumeurs en parallèle :
- soit en les reliant par des dominos,
- soit en les soudant (avant de les introduire dans les moteurs) sur deux fils
de cuivre.
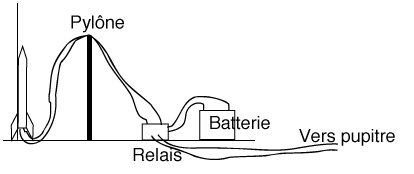
FUSÉES À PLUSIEURS ÉTAGES :
Si, par contre, vous désirez augmenter l'altitude atteinte par votre micro-fusée, il vous faudra l'équiper d'un étage supplémentaire. La réalisation d'une fusée bi-étage est relativement simple. Le second étage sera tout simplement une fusée comme toutes celles que vous avez réalisées. Le premier étage comportera un nombre d'ailerons égal à celui du second étage, collés sur un tube de carton dont la longueur sera égale à celle d'un moteur. Le moteur sera différent de celui utilisé habituellement : ce sera un «impulseur» (sans charge d'éjection de système de récupération) dont le code pourra être A8-0, B14-0, C6-0, ... le dernier chiffre étant toujours zéro.
Le premier étage sera mis à feu comme habituellement, par dispositif électrique. Le second étage est allumé automatiquement par les gaz chauds entraînant des restes de propergol du premier étage à la fin de la combustion.
Problèmes à résoudre :
a) Position des empennages du premier étage :
Ils seront positionnés soit dans le prolongement de ceux du deuxième, sans espace intermédiaire, afin de ne pas créer de turbulences, ou encore en quinconce.
De toute façon, ils devront être de surface plus importante.
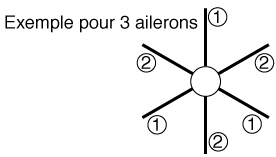
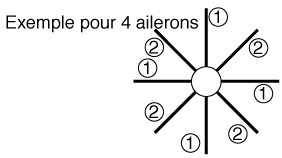
b) Liaison des 2 étages :
Elle se fera à frottement dur, sinon le premier étage n'allumera pas le second. Une méthode simple : laisser dépasser le moteur du deuxième étage de 6 à 8 mm. C'est sur cet espace que vient s'enfiler le premier étage. Quelques tours de ruban adhésif sur cette partie du moteur régleront la force de liaison étage 1 - étage 2.
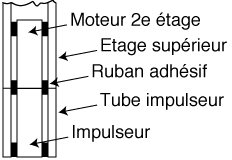
c) Attention :
• la séparation ne doit pas engendrer une déviation de
la trajectoire.
• I'ensemble des 2 étages doit être rééquilibré
exactement comme s'il formait une fusée à lui seul.
NAVETTES

Ce sont des planeurs propulsés par des moteurs et décollant verticalement, comme une fusée. Mais le retour vers la terre s'effectue en vol plané, au lieu de faire appel à un parachute. Il existe quatre types principaux de navettes :
- à moteur arrière,
- à moteur avant,
- à nacelle moteur largable,
- gigogne.
Le problème de stabilité se pose comme pour les mini-fusées. Le moteur, en général, est le plus en avant possible, pour éviter les déviations, surtout au cours de la phase ascendante.
Moteur arrière :
Sur ces modèles, deux des empennages présentent une très
grande surface et constituent les ailes équipées de gouvernes.
Ces gouvernes sont maintenues droites par le moteur, en cours de vol propulsé.
Au moment de l'éjection, les gouvernes se braquent, ce qui a pour effet
de faire légèrement cabrer le modèle et de donner aux ailes
une certaine incidence créant une force de portance qui assure la sustentation
du modèle. L'avant peut être alourdi par un certain nombre d'enveloppes
de moteurs vides, de manière à améliorer la stabilité.
Toutes les gouvernes doivent être parfaitement dans le prolongement du
plan fixe au cours de la phase ascensionnelle du vol.
Le principal problème est la détermination du centre de gravité.
Celui-ci doit être :
- suffisamment en avant pour obtenir une bonne ascension ;
- assez en arrière pour obtenir un bon «plané».
Moteur avant :
Le moteur doit être placé de telle façon que la tuyère soit au niveau de l'axe médian de l'emplanture de l'aile. L'axe du moteur, i'intérieur de la voilure et le plan fixe stabilisateur horizontal doivent être parallèles entre eux.
S'il existe un angle quelconque, le modèle aura tendance à effectuer un looping et s'écrasera au sol avant l'éjection.
L'entretoise supportant la nacelle du moteur doit avoir une épaisseur
d'environ 2 mm. Si elle est trop importante, le décentrement de la poussée
fera piquer l'engin.
Si elle est trop faible, le moteur éjecté frôlera ou heurtera
l'empennage .
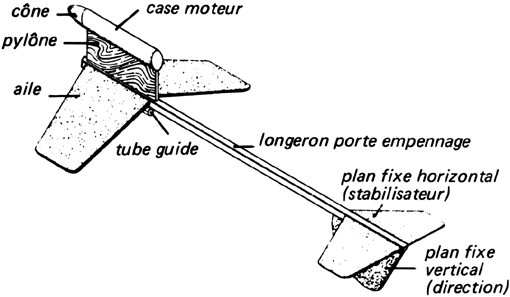
Nacelle moteur larguable :
Un planeur sera d'autant plus performant que son poids et sa résistance au vent seront réduits. Le système de la nacelle larguable se révèle très intéressant.
La fusée récupérée par parachute et par banderole est dépourvue d'empennages, mais elle est équipée d'une broche inclinée à laquelle est accroché le planeur monté libre sur la broche. Il joue un rôle de stabilisateur durant l'ascension.
La réaction due à l'éjection de l'ogive ralentit la nacelle, tandis que l'inertie du planeur déplace celui-ci vers l'avant et le dégage de la broche. Si la broche coince légèrement, la traînée du parachute est, en général, suffisante pour arracher la nacelle.
La nacelle doit être suffisamment libre pour tomber de son propre poids lorsque l'on tient le planeur «nez en l'air».
Sur la tige guide de la rampe de lancement, le planeur et la nacelle sont placés de part et d'autre. Seule cette dernière porte des tubes guides. Moteur, voilure et empennages doivent être, ici aussi, parallèles.
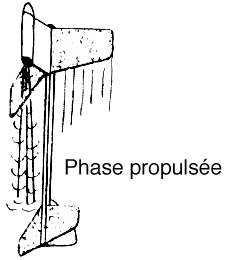
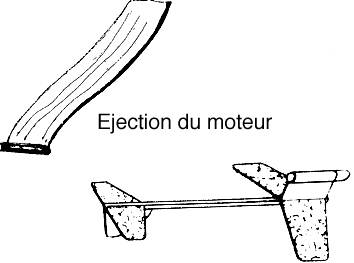
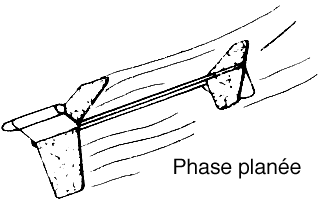
Gigogne :
Deux planeurs sont placés de part et d'autre d'un corps propulseur, sans empennage, équipé d'un dispositif de récupération par parachute.
Sur ce principe on peut créer toute une gamme de réalisations. Dans tous les cas, le corps lanceur doit être très long et très stable.
Le planeur est monté au voisinage du centre de gravité du véhicule lanceur, une broche assez large joignant le planeur au lanceur au cours de l'ascension.
Essai plané :
La navette doit être soigneusement réglée avant le lancement .
Celles à moteur arrière se règlent par braquage des gouvernes jusqu'à ce qu'un vol plané parfait soit obtenu.
Les autres sont réglées par lestage du nez.
Pour bien régler une navette, il faut la lancer sans propulseur, d'un
mouvement doux, à l'horizontale, droit dans le vent (comme l'on ferait
avec un petit avion de papier) :
- s'il décroche, lester le nez
- s'il vire, ajouter un très petit lest sur l'aile placée à
l'extérieur du virage.
Si toutes les recommandations sont suivies, le vol du planeur sera des plus spectaculaires.
ET APRÈES !
Les micro-fusées ne sont bien sûr qu'une étape, destinée à vous introduire dans le monde passionnant de l'Aéronautique et de l'Espace.
Par les techniques complémentaires présentées dans ce chapitre, nous avons voulu vous inciter à aller plus avant, à découvrir les vastes possibilités offertes par ce type d'activité et la progression possible en passant aux mini-fusées, puis, pourquoi pas, aux fusées expérimentales ; mais aussi en découvrant l'Aéronautique par la pratique de l'aéromodélisme (du planeur à l'avion radiocommandé). Ces pratiques, tout en abordant des domaines variés, tels la mécanique, l'aérodynamique, la météologie ou des techniques nouvelles (télécommande, électronique) sont un outil pédagogique très puissant pour l'acquisition de la méthode expérimentale par les jeunes.
Quant à vous, éducateurs, elles vous offrent la possibilité de mettre les enfants qui vous sont confiés en prise directe avec un monde en constant devenir, dans lequel sciences et techniques ont un rôle sans cesse grandissant.
