
7- LA MESURE
Lancer sa micro-fusée, la voir
évoluer, ca y est, le rêve est devenu réalité. Mais
faut-il en rester là ? Bien sûr que non : c'est seulement à
partir de maintenant que va démarrer la première démarche
scientifique. Il va falloir mesurer. Et la première pensée du
lanceur est celle-ci : «A quelle hauteur a bien pu monter mon engin ?».
Traduction scientifique : «Quelle est l'altitude du point de culmination
?».
LA MESURE D'ALTITUDE
Une méthode relativement simple consiste à procéder par visée à l'aide d'une alidade.

La fusée n° 1 ayant atteint une altitude h1 fait avec le sol un
angle a1.
La fusée n° 2 ayant atteint une altitude h2 > h1 fait avec le
sol un angle a2 > a1.
Il nous faut donc mesurer cet angle qui nous permettra par un calcul qui sera exposé plus loin, de déterminer l'altitude atteinte.
Construction d'une alidade simple :
A l'aide d'un rapporteur type «école».
La photo ci-dessous vaut mieux qu'un long discours. Le rapporteur est fixé
sur une cornière par quelques vis ou rivets dont la tête ne doit
pas dépasser. Le viseur, ici une simple cornière munie d'un œilleton
de visée pivote à frottement doux exactement au centre du rapporteur.
Il faut pouvoir suivre la fusée sans fournir d'effort trop important,
mais il faut aussi que le viseur garde la position correspondant à la
culmination (un petit truc : la rondelle en nylon).

Cet ensemble rapporteur-cornière-viseur doit pouvoir pivoter en douceur sur une embase qui sera rendue solidaire d'un pied. Ici, toutes les astuces sont permises et diffèrent selon le modèle de pied que vous avez en votre possession. Un bon pied photo fera l'affaire. Mais tout le monde n'a pas ce genre d'accessoire à sa disposition.
Voici une idée, pour un pied simple et bon marché fabriqué à partir de matériel de récupération.
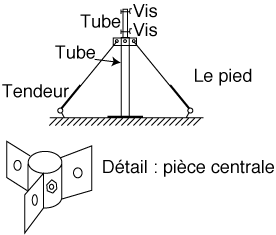
La photo ci-dessous montre une autre alidade basée sur le même principe général, mais réalisée à partir d'un rapporteur de mécanicien.


Le traitement de la mesure d'altitude :
Lorsque l'angle a est mesuré, il faut pouvoir le ramener à
une altitude.
En supposant que la fusée s'élève verticalement au-dessus
de la rampe, il suffit de reporter la distance entre le théodolite et
la rampe sur une feuille quadrillée, puis l'angle a.

L'intersection entre la verticale de la rampe et la visée donne le point de culmination. L'altitude h se mesure alors directement.
La résolution trigonométrique est : h = l . tg(a) avec h et l en mètres. (tg = tangente)
Pour obtenir une bonne précision des mesures, quelques règles sont à respecter absolument :
- le support de l'alidade doit être à l'horizontale (utiliser
pour cela un niveau à bulle).
- la distance entre l'observatoire et la rampe doit être proche de l'altitude
atteinte par la fusée.
- la fusée «remontant» le vent, l'observatoire doit être
installé perpendiculairement à l'axe rampe- direction du vent.
- I'observatoire ne doit pas être placé face au soleil.

Ensuite, que peut-on encore mesurer ?
Tout simplement le temps de vol de la fusée :
- le temps de la montée
- puis le temps de descente,
à l'aide d'un chronomètre bien sûr et l'on en déduira
la vitesse moyenne à l'aide de la formule :
vitesse = distance parcourue / temps
Et encore la distance du point de chute au pied de la rampe de lancement
à l'aide d'une chaîne d'arpenteur.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire car l'instant du départ
et l'instant de la culmination ne sont pas toujours bien repérés.
- le départ : il existe un certain décalage, variable selon la batterie et la longueur du fil de mise à feu, entre le zéro du compte à rebours et l'instant exact où la fusée commence à s'élever. Il faut donc déclencher son chronomètre à cet instant précis. L'habitude sera vite prise.

- la culmination : lorsque le ciel est chargé de nuages, ou si les couleurs de la fusée se confondent avec le ciel, il est difficile de voir le point exact de culmination, qui ne se situe pas toujours au moment de l'éjection du système de récupération, visualisé par un petit panache de fumée. Là aussi, ce sera l'habitude qui permettra de reconnaître la culmination.

Cette remarque à propos de la culmination est aussi valable pour la mesure d'altitude. Il faut s'habituer à suivre ses micro-fusées et ce n'est pas facile pour les premières fois car on est surpris par la vitesse atteinte en quelques dixièmes de seconde .
Les erreurs : les risques d'erreur sont donc importants et le meilleur moyen de les diminuer est d'effectuer un double chronométrage et une double mesure d'altitude.
LE TRAITEMENT ET L'EXPLOITATION DES RÉSULTATS
De retour de la campagne de lancement, nous nous trouvons face à de nombreuses observations et mesures qui serviront à expliquer le vol et les performances des fusées lancées.
PREMIÈRE PHASE : LE TABLEAU RÉCAPITULATIF
Toutes les caractéristiques doivent être regroupées sur
un tableau récapitulatif. Les différents observateurs complètent
ce tableau suivant la tâche qu'ils s'étaient assignée avant
la campagne.
Si une mesure n'a pu être faite, tracer un tiret dans la case correspondante
pour éviter de confondre avec une case pas encore remplie.
Le tableau contient toutes les informations à l'état brut, il
faut donc traiter les informations avant de les utiliser.

A la fin de l'établissement de ce tableau, il est possible de supprimer
les quelques résultats aberrants (mauvaise mesure, incohérence,
...) .
Mais par le fait qu'il contient toutes les informations, le tableau manque de
clarté, car trop chargé. Nous en extrairons quelques informations
importantes que nous présenterons plus simplement.
DEUXIÈME PHASE : LE GRAPHIQUE
Nous prendrons la ou les mesures qui nous intéressent directement et
nous les représenterons sur un graphique, si possible en respectant un
ordre d'évolution par exemple par rapport au paramètre étudié
(la masse de la fusée, la surface des ailerons...).
Sur ce graphique, devront apparaître les mesures, les moyennes éventuelles,
les évaluations d'erreurs et les remarques.
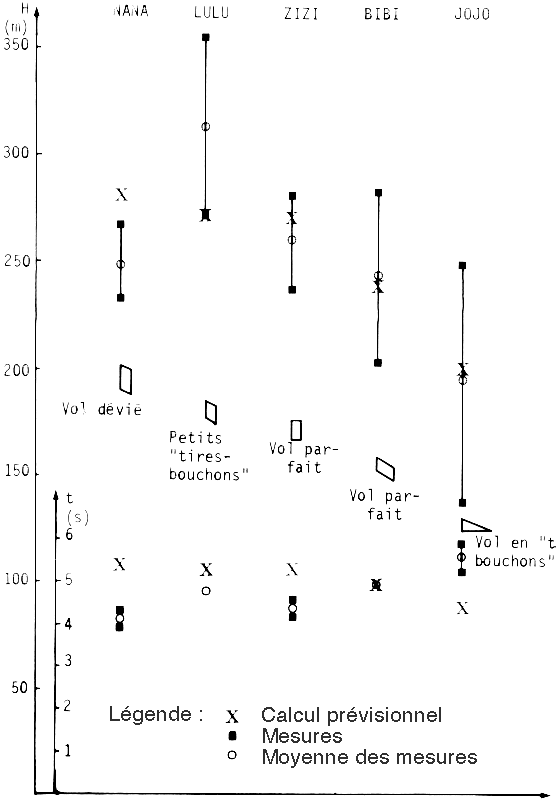
TROISIÈME PHASE : L'EXPLOITATION
Il s'agit maintenant pour nous de tirer des enseignements des résultats
obtenus. S'ils sont cohérents, nous en déduirons des lois de variations,
des ordres de grandeurs et surtout des explications sur le déroulement
du vol.
S'ils ne le sont pas (et ils ne le sont jamais tous), nous analyserons les raisons
des erreurs et des échecs expérimentaux. Nous en définirons
ensuite des nouvelles conditions expérimentales pour répondre
aux questions auxquelles nous n'avons pu répondre.
QUATRIÈME PHASE : LA CONCLUSION
Il faut conclure : il ne suffit pas de faire une analyse détaillée des résultats. Avant de repartir à dessiner, construire et lancer notre prochaine fusée, nous devons faire la synthèse de ce que nous avons obtenu et en déduire une ligne d'action pour la prochaine construction.
C'est au prix de cette réflexion, parfois difficile mais toujours enrichissante que nous ne resterons pas dans un «tâtonnement sauvage» sans valeur de formation. C'est la condition essentielle d'un véritable projet.
Et n'oublions pas notre carnet et notre crayon pour prendre des notes sur le terrain de lancement !