
9 - AUTOUR DE L'AILE
LE STABILISATEUR
Les notions aérodynamiques applicables à l'aile sont
aussi applicables au stabilisateur, avec quelques particularités.
LE STABILISATEUR N'EST PAS CALÉ AU MÊME ANGLE D'INCIDENCE QUE
L'AILE
En général, par rapport au dos du fuselage, l'aile est calée
à 3 ou 4° d'incidence tandis que le stabilisateur est à peu
près à 0° (ou à un calage légèrement
négatif).

Le stabilisateur travaille donc avec une portance et une traînée faibles (voir page sur la polaire).
CONCLUSIONS
- Il aura peu d'efforts à supporter, sa structure pourra être
légère.
- les différences de pression entre extrados et intrados étant
faibles, les tourbillons marginaux seront atténués et les moyens
de les combattre seront moins importants que pour l'aile : l'allongement pourra
être réduit, les saumons simplifiés (Ce qui ne veut pas
dire que l'on peut négliger ces points).
TOUT EXCÉDENT DE POIDS SUR LE STABILISATEUR EST MULTIPLIÉ AU LESTAGE.
Se reporter au croquis suivant : le poids du stabilisateur doit être compensé par un poids de lest trois, quatre ou cinq fois supérieur, selon les rapports des bras de levier réalisés.
CONCLUSION
- travailler, à fond, la légèreté de la structure
et celle du revêtement (souvent aussi lourd, voire plus lourd, que la
structure).
- Nervures en balsa fin et tendre, baguettes toutes en balsa (3x3, 2x2, 3x2,
etc... ).
- Papier fin, couches d'enduits fines (le vrai papier Japon, absorbant peu d'enduit,
reste tres léger).
- Déthermalisateur, crochets très légers (corde à
piano de 5 à 10/10, pas au-dessus).
- Plaquette support réduite à son minimum.
LE STABILISATEUR DOIT DÉVELOPPER UNE PORTANCE :
C'est la portance du stabilisateur qui permet de reculer le centrage de l'appareil. Sans elle, le centrage devrait se faire sous le centre de poussée de l'aile (environ 33% de la corde au lieu de 50, 55% couramment admis).
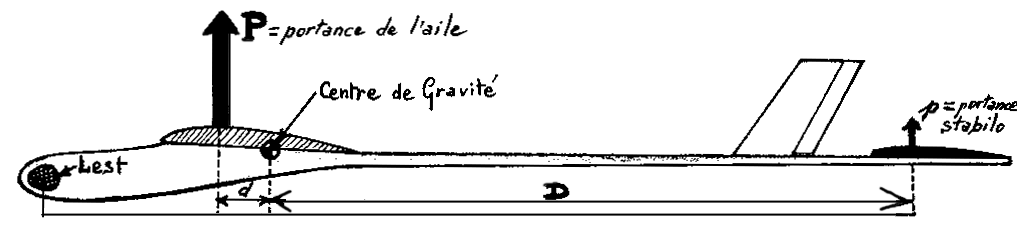
ÉQUILIBRE DU PLANEUR EN VOL
P x d = p x D
CONCLUSION : utiliser pour les stabilisateurs des profils développant
une bonne portance à faible incidence (profils minces et creux).
EN ANNEXE À CETTE ETUDE : DÉTERMINATION
RAPIDE DU CENTRAGE NORMAL D'UN PLANEUR
Le calcul de P et p présentant des difficultés, utiliser la formule d x S = D x s x 0,4 (d et D voir croquis - S et s : surfaces aile et stabilisateur) le coefficient 0,4 qui est un coefficient approché, exprime le fait que le coefficient de portance (Cz) du stabilisateur est inférieur à celui de l'aile (incidence faible et position dans un écoulement perturbé par l'aile).
LE FUSELAGE - Ses qualités
Le fuselage n'est qu'un organe de liaison
entre l'aile, le stabilisateur, la dérive, le lest.
QUALITÉS ESSENTIELLES À EN ATTENDRE :
- Résistance à la déformation
- Légèreté
- Traînée aérodynamique minime.
RÉSISTANCE À LA DÉFORMATION
Au niveau du perfectionnement, nous n'utiliserons plus de fuselages
taillés dans une planche de balsa, ou formés d'une seule grosse
baguette, plus de fuselages formés d'une structure entoilée.
Nous choisirons soit une structure coffrée (cas le plus fréquent),
soit une fibre de verre. Voir les plans proposés par le CLAP, voir le
CHAPITRE 14 consacré à la construction.
LÉGÈRETÉ
La recherche de la légèreté portera au maximum
sur les parties situées en arrière du centre de gravité
(revoir un peu plus haut l'importance de la légèreté du
stabilisateur).
La recherche de la légèreté portera sur l'épaisseur
et la densité des bois qui seront dégressives d'avant en
arrière, sur l'arrondi de tous les angles, sur la finition (pas de
peinture lourde en particulier).
Une fibre de verre, souvent plus résistante qu'il n'est utile, pourra
être amincie, allégée par ponçage, dans la partie
arrière surtout.
Tous les accessoires à l'arrière seront très légers
(aucun crochet en c.à.p. de plus de 10/10, aucune vis de réglage
de plus de 2 mm de diamètre).
TRAÎNÉE AÉRODYNAMIOUE MINIME
Sont à travailler :
- l'état de surface
- la forme aérodynamique
ÉTAT DE SURFACE
Revoir les conseils de finition, travail de Lucien
Beyer dans Aviation-Clap n°16, de mars 69.
Cliquer ici pour accéder au document.
L'essentiel en est repris dans les chapitres consacrés à la construction
qui terminent cet opuscule (chapitres 10 à 15).
FORME AÉRODYNAMIQUE :
- Recherche de formes parfaitement fuselées.
- Aucun angle vif.
- Aucune surface, si petite soit-elle, perpendiculaire à l'écoulement
de l'air.
- Maître-couple (section maximum du fuselage) réduit tant
que faire se peut.
- Diminution de la SURFACE MOUILLÉE (c'est-à-dire en contact
avec l'air) pour diminuer l'effet de viscosité de l'air, surtout en arrière
de l'aile dans une zone où l'air est inévitablement turbulent.
- Soin des raccords avec l'aile et le stabilisateur.
- Élimination des bracelets de caoutchouc s'ils gênent l'écoulement.
On en arrive à des formes comparables à celles utilisées
sur les actuels planeurs pilotés de grande performance : avant globulaire
suivi d'un tube mince (fibre de verre, ou moulage kraft-balsa dit KBKBK ; ou
structure de bois arrondie, ou... etc... à vous de chercher).

RÉPARTITION DES MASSES
INFLUENCE SUR STABlLITÉ ET VIRAGE
Soient deux planeurs identiques de forme, de dimensions et de masse totale.
- L'un dont la masse est repartie également sur toute la surface, soit,
en moyenne sur le GRAND CERCLE C de rayon R.

- L'autre dont la masse a été concentrée au maximum près du centre de gravité soit, en moyenne, sur le petit cercle c, de rayon r.

La mise en rotation de la masse totale (M) , pour mise en virage, ou
pour retour à la position normale de vol, nécessite un travail
plus important quand cette masse se trouve éloignée du centre
de gravité (déplacement d'une même masse sur une distance
plus importante).
Travail proportionnel au carré du rayon.
En conséquence, sur le deuxième appareil, dont la masse est concentrée près du centre de gravité, l'action du dièdre, celle du stabilisateur, celle du volet de direction se trouvent facilitées.
CONCLUSION PRATIQUE : alléger toutes les extrémités (extrémités des ailes, arrière du fuselage, stabilisateur) et raccourcir le nez pour rapprocher le lest du centre de gravité. Evidemment la quantité de lest nécessaire augmentera, mais, le reste de la construction étant allégé, le poids total pourra rester constant (ou à peu près).
Exemple : les planeurs de concours, de la formule dite "Nordique"
ont un poids minimum fixé a 410 grammes.
Ils sont construits actuellement par les meilleurs spécialistes avec
un nez extrêmement court (5 ou 6 cm en avant de l'aile par exemple).
Eviter en particulier de construire un nez très long (1 corde 1/2 ou
2 cordes d'aile) dans le but de ne placer qu'un lest minime.
Cela donne des planeurs ayant une mauvaise stabilité longitudinale et
sur lesquels on doit augmenter la surface de la dérive.
Les trois axes de rotation
Trois termes aéronautiques à assimiler : Tous les mouvements de nos appareils se font autour du centre de gravité, selon trois axes.
1- AXE DE TANGAGE
Parallèle à l'aile
- Basculement d'avant en arrière
- Action du stabilisateur.
2- AXE DE ROULIS
Du nez à l'arrière du fuselage
- Inclinaison à droite et à gauche
- Action du dièdre (ou des ailerons).
3- AXE DE LACET
Perpendiculaire à l'aile passant au C.G. (souvent vertical mais
pas toujours)
- Rotation à droite et à gauche
- Action de la gouverne de direction et de la dérive.
